« La gouvernance des océans et l’économie bleue restent encore insuffisamment valorisées dans le partenariat Afrique–Europe. Le secteur privé africain a un rôle essentiel à jouer pour les placer au cœur de la coopération entre les deux continents »
Pèsant jusqu’à près de 450 milliards de dollars par an, l’économie bleue est l’un des moteurs de croissance les plus prometteurs pour l’Afrique — et un champ stratégique de coopération avec l’Europe. Pourtant, ce potentiel reste encore largement ignoré dans le partenariat UA–UE, alerte plusieurs acteurs installés à Bruxelles. À l’approche du sommet entre les deux continents, Aziz Boughourbal, PDG d’Africa Ocean Group, revient pour Financial Afrik sur les enjeux majeurs de cette relation et sur les raisons pour lesquelles l’économie bleue devrait figurer au cœur des priorités politiques.
Pourriez-vous présenter brièvement votre groupe ?
Aziz Boughourbal : Africa Ocean Group est actif depuis 1987 et intervient principalement dans la pêche et les services maritimes. Nous sommes un groupe pionnier dans le sens où nous avons été les premiers en Mauritanie à implanter des usines de traitement de poissons pélagiques à terre. Cette rupture avec les pratiques exclusivement en mer a permis de créer une véritable valeur ajoutée locale et de soutenir l’économie nationale. Aujourd’hui, nous sommes devenus un acteur de référence en Afrique de l’Ouest, certifié selon les normes internationales du secteur, avec des exportations vers la sous-région, l’Europe et plusieurs marchés asiatiques. L’ensemble repose sur trois usines modernes et une flotte de 23 navires dont nous sommes les propriétaires. .
Comment avez-vous financé la mise sur pied de ces usines ?
A.B. : À l’époque, il n’existait quasiment aucune production de pélagiques en Mauritanie. Rien n’était débarqué : la pêche était réalisée et exportée en mer par des navires étrangers. Nous avons donc lancé un projet pilote pour créer une filière de traitement à terre. Très vite, nous avons été confrontés à un obstacle majeur : le financement, environ 30 millions d’euros, que les banques locales ne pouvaient assumer. Nous nous sommes alors tournés vers la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds de l’OPEP, qui ont apporté en 2005 à notre filiale SEPH S.A. un financement de 10 millions de dollars permettant de transformer cette initiative en un véritable complexe industriel, flotte incluse. C’est l’un des rares cas où la BEI a financé directement le secteur de la pêche. Les résultats ont été remarquables : de zéro tonne produite à terre, nous atteignons aujourd’hui près de 32 000 tonnes par an.
Un sommet UA–UE aura lieu prochainement. Comment évaluez-vous la relation entre les deux partenaires dans le domaine de l’économie bleue, notamment en Mauritanie ?
A.B. : La Mauritanie a depuis longtemps compris l’importance stratégique de la pêche, pilier essentiel de l’économie nationale. En 2023, le secteur représentait 2,8 % du PIB, 66 000 emplois directs, 300 000 indirects, 14,9 % de la production du secteur primaire et près de 20 % des recettes d’exportation. Le pays a très tôt misé sur la régulation et la mise aux normes de la filière, en adoptant le système sanitaire européen pour toutes les entreprises et tous les navires opérant dans ses eaux. Aujourd’hui, la Mauritanie est le deuxième pays au monde à obtenir la conformité globale FiTI (Fisheries Transparency Initiative), un gage de transparence unique dans la sous-région.
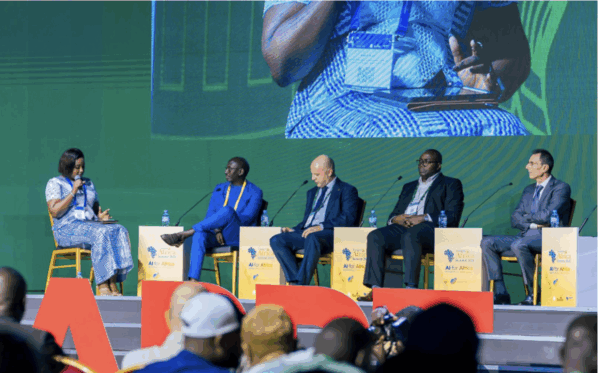
En dehors de l’élément sanitaire, quel est votre observation sur l’état actuelle de la collaboration?
A.B. : Malgré plusieurs accords de partenariat signés avec des pays africains — dont celui qui lie l’UE à la Mauritanie jusqu’en 2026 — je pense que les institutions européennes ne mesurent pas encore pleinement le potentiel structurant de l’économie bleue dans la relation UE–Afrique. La Fondation Afrique-Europe elle-même souligne que la coopération océanique reste largement négligée dans le partenariat entre l’Afrique et l’Europe. Pourtant, l’économie bleue africaine pourrait dépasser 1,5 trillion de dollars par an d’ici 2050 et jouer un rôle considérable dans plusieurs domaines comme la réduction migratoire des citoyens africains, où des catastrophes humaines ont fréquemment lieu, vers l’Europe.
Comment ?
A.B. : Grâce au financement européen, notre groupe a pu créer plus de 3000 emplois directs. En appliquant les ratios de développement africains, cela représente plus de 40 000 personnes dont les moyens de subsistance dépendent de notre entreprise et les incitent donc à rester. C’est dans ce contexte que nous avons entrepris des démarches auprès des organisations basés à Bruxelles afin de sensibiliser à l’importance du secteur privé africain — notamment les industriels de la pêche — dans la création d’emplois locaux. Il est essentiel que l’économie bleue soit davantage intégrée dans le partenariat entre l’Europe et l’Afrique.
Les industriels sont souvent accusés de surpêche par certaines ONG, notamment européennes. Ces critiques sont-elles fondées ?
A.B. : Les ONG ont évidemment un rôle clé à jouer. Cependant, beaucoup — souvent étrangères — ont tendance à considérer l’ensemble des acteurs industriels comme un bloc homogène, sans distinguer ceux qui respectent strictement les règles de durabilité de ceux qui ne le font pas. Cette approche porte des préjudices graves aux opérateurs responsables.
Ces organisations apporteraient-elles alors une analyse biaisée de la réalité ?
A.B. : Je parlerais plutôt d’une lecture incomplète de la situation. Certaines ONG formulent leurs critiques de la pêche industrielle à partir d’observations locales et de témoignages de pêcheurs artisanaux, sans toujours disposer d’une vision complète du secteur. Cette approche, légitime dans son intention, peut toutefois omettre des éléments essentiels : les données statistiques disponibles, la diversité des pratiques, ainsi que le rôle économique de la pêche industrielle. Dans plusieurs pays, la pêche artisanale reste confrontée à des contraintes techniques affectant parfois la qualité d’une partie des captures, tandis que la pêche industrielle produit généralement des volumes destinés exclusivement à la consommation humaine et répondant à des standards de qualité plus élevés. D’où l’importance d’examiner l’ensemble de la filière, afin que l’analyse ne repose pas uniquement sur des perceptions ponctuelles ou des situations isolées.
Comment changer la donne ?
A.B. : Pour contribuer à une meilleure compréhension du contexte, nous avons choisi, dans un esprit d’ouverture, d’accueillir des organisations comme Greenpeace. Nous souhaitons leur présenter en toute transparence nos pratiques de durabilité, nos politiques environnementales élaborées avec nos partenaires européens, ainsi que la manière dont nous collaborons avec les pêcheurs artisanaux pour l’exportation de produits « nobles » vers des marchés étrangers, comme l’Espagne. Et nos efforts pour renforcer ce dialogue ne s’arrêtent pas là.
C’est-à-dire ?
A.B. : À travers notre filiale Omaurci S.A., nous sommes membres actifs du Fishery Improvement Project (FIP). Aux côtés des associations, des pouvoirs publics, des scientifiques et d’autres acteurs privés, nous travaillons collectivement à la mise en place de pratiques conformes aux standards internationaux de gestion durable des pêcheries. Les études et les échanges menés dans ce cadre montrent que les activités actuelles de pêche en Mauritanie se situent autour de 600 à 700 000 tonnes par an, pour une capacité totale estimée à 1,2 million de tonnes. Des chiffres qui démontrent que nous sommes loin d’une situation de surpêche. Une marge qui sous-entend que des grands groupes locaux, comme le nôtre, peuvent continuer à mener sereinement leurs activités et contribuer de manière significative aux recettes fiscales, à l’économie locale, aux services maritimes, à la réparation navale et à l’approvisionnement, tout en participant à la lutte contre l’insécurité alimentaire dans la sous-région, où 90 % de nos produits pélagiques sont exportés.



