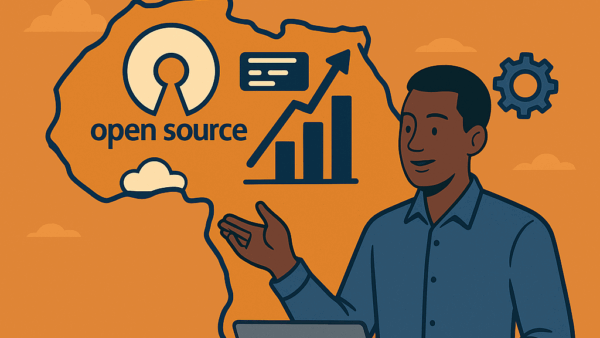En prélude au Fintech Mauritanie Hackathon qui se tient les 22 et 23 juillet 2025 à Nouakchott sur le thème de l’innovation au bénéfice de la jeunesse, de l’environnement et de l’inclusion des femmes, Financial Afrik a demandé à un trio d’experts montpelliérains œuvrant dans l’univers du Libre dans 19 pays de la Francophonie, dont 14 en Afrique, d’expliquer pourquoi les gouvernements et les entreprises africaines ont intérêt à davantage utiliser les logiciels libres pour assurer leur développement.
Par Christine Holzbauer, envoyée spéciale à Montpellier
Les manifestations high-tech d’envergure se multiplient en Afrique, avec autant de nouvelles opportunités créées pour les 400 millions de jeunes âgés de 15 à 35 ans qui représentent un marché colossal. Après l’organisation du premier salon GITEX Africa à Marrakech en 2023 par Dubaï World Trade Center (DWTC), sous l’autorité du gouvernement du Maroc, l’intrusion de l’IA sur le continent a fait de la troisième édition (14-16 avril 2025) de ce salon professionnel un rendez-vous incontournable des jeunes créateurs. À Kigali, la deuxième édition du FinTech Forum (24-26 février 2025) a permis de mettre l’accent sur la transformation numérique du secteur financier et le rôle clé des technologies financières dans l’expansion de l’inclusion financière. La Mauritanie aspire maintenant à devenir une plateforme pour les start-up subsahariennes les plus performantes en primant leurs créateurs. D’où l’initiative du groupe Financial Afrik d’organiser la première édition du Fintech Mauritanie Hackathon à Nouakchott, dédié à « l’innovation pour un avenir durable : jeunesse, environnement et inclusion des femmes », qui fera la part belle aux logiciels libres.
Ce choix s’explique par la nécessité de renforcer la souveraineté numérique en Afrique. En offrant un accès libre au code source, les logiciels libres permettent à la puissance publique comme aux entreprises de personnaliser, d’adapter et de sécuriser leurs outils numériques selon leurs besoins spécifiques. Or, cette autonomie technologique est cruciale pour renforcer la souveraineté du continent. D’autant que les 54 États africains dépendent largement de technologies étrangères, notamment américaines et chinoises, dans des domaines clés tels que les systèmes d’exploitation, les infrastructures télécoms et les services numériques. Cette dépendance les expose à des vulnérabilités stratégiques, entravant à la fois leur capacité à contrôler leurs données, leurs infrastructures ainsi que leurs politiques numériques. À un moment où des logiciels libres tels que GNU/Linux, Firefox, Ubuntu, Emmabüntüs, VLC ou WordPress, et beaucoup d’autres, transcendent la technique.
L’univers du Libre, un monde à (re)découvrir !
Œuvrant depuis une quinzaine d’années dans l’univers du Libre, la juriste et entrepreneure sociale Myriam Criquet, PDG de la SAS Kalimbra, et son compagnon, Pascal Anoux, un informaticien qui a fondé en 2008 le groupe d’utilisateurs Montpel’libre pour promouvoir le logiciel libre, la culture libre et les communs numériques, ont créé — ensemble — en 2020 les Rencontres Amicales du Logiciel Libre (RAFLL), réunissant 19 pays francophones dont 14 africains, qu’ils pilotent depuis. « On parle désormais avec ces rencontres de la référence francophone du Libre ! », insiste Myriam Criquet. Celles-ci ont été suivies par les Journées Trimestrielles d’Études (JTE). « Ce qui permet tout au long de l’année de travailler sur des sujets d’actualité afin de mieux fédérer les communautés », précise-t-elle. Ils ont récemment été rejoints par Abdourahmane Koita, mathématicien et ancien consul du Sénégal à Bordeaux puis à Marseille, qui est le président d’honneur de Montpel’libre et de l’association Action d’Intérêt Collectif (API), — créée par Myriam Criquet en 2018 —, membre du Comité stratégique et du Comité de programme des RAFLL et de leur JTE. Il est aussi directeur général de A2K Teranga Consulting, un cabinet de conseil avec une approche multisectorielle.
Pour ce scientifique chevronné, la faible compétitivité des économies africaines s’explique par la fragmentation des marchés. « S’ils veulent davantage peser dans l’économie mondiale, les États africains doivent relier leurs intelligences et créer en commun pour maximiser leur chance d’un développement durable. À travers le Libre et les “biens communs” (NDLR : quelque chose qui n’appartient à personne mais que tout le monde utilise), il devient possible d’innover et donc de faire d’importants sauts technologiques pour pallier le manque de structuration dans les filières économiques et aller vers l’industrialisation du continent », commente-t-il. En plus de favoriser la créativité et parce qu’ils renforcent les liens entre les communautés, « les logiciels libres leur permettront in fine de peser sur l’économie mondiale. »
Grâce à des initiatives comme Smart Africa, des données critiques au continent sont sécurisées à grande échelle. À travers un « cloud panafricain » et à partir de technologies open source, celles-ci sont hébergées en toute sécurité. En avril 2025, lors de la 20ᵉ réunion à Kigali de son Comité de Pilotage coprésidé par le Secrétaire général de l’UIT et le Commissaire à l’énergie et aux infrastructures de l’Union africaine (UA), les États membres de l’Alliance ont adopté une série de résolutions stratégiques visant à accélérer la transformation numérique de l’Afrique en partenariat avec des bailleurs et des acteurs du secteur privé. Beaucoup, toutefois, reste à faire pour fédérer les différentes communautés d’utilisateurs dans le cadre de la Francophonie.
Un moteur d’accélération des ODD
Parce qu’ils réduisent les coûts liés aux licences et favorisent l’innovation locale, les logiciels libres stimulent la création d’entreprises technologiques et accélèrent l’émergence de solutions adaptées aux réalités du continent. Le secteur de l’éducation est particulièrement concerné. Des initiatives comme Baobab Edu au Sénégal et au Mali ont permis de moderniser le système éducatif et de réduire — ce faisant — la fracture numérique. D’autres outils comme Open-Sankoré— un logiciel de tableau numérique interactif déployé dans plusieurs pays africains pour faciliter l’accès aux ressources pédagogiques — ou Afrikalan, qui démocratise l’accès aux logiciels éducatifs libres en Afrique de l’Ouest grâce à des ordinateurs Raspberry Pi adaptés aux environnements locaux, se sont soldés par l’implantation — à ce jour — de plus de 130 bibliothèques au Mali, en Guinée, à Madagascar et au Sénégal. « L’université virtuelle dans ce pays est un excellent exemple dans la diffusion des connaissances tenant compte de l’équité territoriale », commente Abdourahmane Koita.
GestCarpa, au Burkina Faso, assure par ailleurs une gestion efficace des ressources financières des avocats grâce à une solution locale basée sur Linux. Pour Pascal Anoux, si l’usage des logiciels libres contribue à dynamiser les économies locales tout en créant des emplois, « c’est aussi une démarche collaborative sans hiérarchie. Il s’agit donc de mettre davantage l’accent sur les ressemblances plutôt que sur les différences », argue-t-il. « L’Afrique est la terre d’élection du logiciel libre », renchérit Myriam Criquet, du fait qu’elle est prédisposée par sa sagesse, sa culture (incluant le droit coutumier) et son histoire « à régir les droits et les obligations des individus envers leurs communautés par l’organisation des liens entre eux. » Pour elle, « le Libre est un bien commun à préserver pour une société durable et prospère, seul compatible avec les 17 Objectifs de Développement durable (ODD) fixés par les Nations unies », parmi lesquels l’autonomie éducative figure en bonne place, insiste-t-elle.
Ne pas répéter les erreurs de l’Europe
Si l’intégration des logiciels libres dans les programmes éducatifs africains est la clé pour former une nouvelle génération de développeurs, d’ingénieurs et de décideurs capables de concevoir et de gérer des solutions technologiques autonomes, l’Afrique doit trouver sa voie. « Il s’agit d’apprendre aux différentes communautés à utiliser et à développer les outils numériques sans reproduire les difficultés que les autres continents ont connues. Pour cela, seule une intelligence collective permettra de faire le saut technologique nécessaire », affirme Abdourahmane Koita. Fabuleux outils de transformation sociétale, les logiciels libres sont de « puissants vecteurs pour promouvoir la diversité culturelle africaine, d’une richesse extraordinaire », précise-t-il.
Hélas, déplore Pascal Anoux, le continent n’utilise pas assez les logiciels libres et, du coup, ses décideurs se laissent influencer par les GAFAM ! « La difficulté, c’est la perception du Libre qui est considéré uniquement comme un logiciel gratuit. Alors que la véritable importance de ce logiciel, c’est de pouvoir s’approprier l’IA open source avec la possibilité de la comprendre, de la modifier ou de la mettre en conformité avec ses besoins », explique-t-il. En d’autres termes, même si les GAFAM lui font les yeux doux, rien n’empêche l’Afrique d’aller « résolument » dans le Libre, à condition de mieux en cerner tous les enjeux !
Myriam Criquet est — elle aussi — convaincue que l’Afrique doit éviter de reproduire les erreurs de l’Europe. « Avec l’irruption de l’IA, la vie dans notre société a été bouleversée : consommation, exercice du travail, vote, santé. C’est pourquoi il est fondamental que les IA que l’Afrique va utiliser soient open source », préconise-t-elle. D’autant que, grâce à des problématiques et des cultures différentes (moins d’eau, moins d’argent !), mais aussi grâce à sa jeunesse et à sa créativité, « l’Afrique est plus novatrice et peut donc être précurseur dans des domaines comme le numérique frugal ou sobre », ajoute-t-elle.
Transmission et innovations sociales
D’où la nécessité de continuer à mener des actions de sensibilisation à grande échelle. « Les professionnels dans les entreprises, les associations, les institutions, les territoires ont également besoin d’être formés sur les quatre libertés du Libre, ainsi que sur les enjeux et les défis du numérique. » En s’appuyant sur le travail déjà effectué par Montpel’libre et l’association API dans 19 pays dont 14 en Afrique, Myriam Criquet préconise la multiplication des formations et l’accélération des recherches afin d’optimiser et rendre plus impactant l’univers du Libre. « Il nous faut créer davantage d’événements locaux, nationaux, internationaux, avec des fiches techniques, des guides, des livres blancs, des plateformes numériques écrits en commun ; et que des fonds spécifiques soient créés par des institutionnels locaux, nationaux ou internationaux via des appels à projets, à manifestation, ou par appel d’offres ou bien par des fondations », insiste-t-elle.
Il est également urgent, selon Abdourahmane Koita, d’identifier et de cartographier l’univers du Libre et de ses usages pour une meilleure efficacité dans l’action mais aussi pour lui donner davantage de visibilité. La Fondation Africaine des Logiciels Libres et Open Source (FOSSFA) a joué — un temps — ce rôle de précurseur. IDLELO, fondée par l’Association pour le Progrès des Communications (APC), a travaillé de son côté à promouvoir l’utilisation d’internet pour la justice sociale et le développement durable. Aujourd’hui, des événements comme les Rencontres Amicales Afrique-France du Logiciel Libre, initiées et dirigées par Pascal Anoux et Myriam Criquet (NDLR : devenues les Rencontres Amicales Francophones du Logiciel Libre avec l’arrivée de la Suisse, la Belgique, le Québec et le Vietnam), ainsi que les Journées Trimestrielles d’Étude, vont plus loin. À partir d’exemples concrets, le Hackathon de Nouakchott des 22 et 23 juillet permettra de rappeler l’importance pour l’Afrique de bâtir une infrastructure numérique souveraine, inclusive et durable. Reste au trio de choc venu de Montpellier à convaincre les participants que le Libre peut gagner ses lettres de noblesse en Afrique, à condition d’investir dans la formation et la promotion de solutions open source !